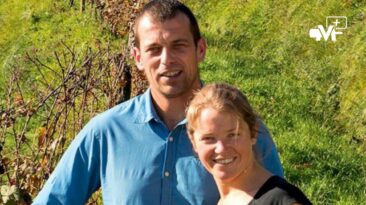Fondé en 1984, le domaine de la Rectorie, dirigé aujourd’hui par Jean-Emmanuel Parcé, s’est fait connaître pour ses Banyuls Rimage et ses Collioure blancs. Avec 34 hectares de vignes, le domaine mise sur une réduction de ses surfaces, sur la transition bio et sur des pratiques novatrices pour faire face aux défis climatiques, tout en valorisant les spécificités de ses terroirs. Jean-Emmanuel, pouvez-vous nous présenter le domaine de la Rectorie ? C’est un domaine qui a été créé en 1984 par mon père Thierry et mon oncle Marc. Ils avaient sorti les vignes qui partaient à la cave coopérative. Ces vignes appartenaient à leur grand-mère. Ils voulaient produire leur propre vin et pas seulement apporter les raisins à la cave coopérative. Au départ, ils avaient 7 hectares, puis, petit à petit, ils se sont agrandis. Depuis 2010, je suis uniquement avec mon père. Quelle surface avez-vous aujourd’hui et comment votre domaine a-t-il été reconnu ? Nous sommes à 34 hectares. C’est très morcelé, il y a des micro-terroirs. Depuis 2013, je mets en avant des lieux-dits, avec des expositions vers la mer, qui ne souffrent pas de la sécheresse. Le domaine s’est fait connaître au début avec les Banyuls Rimage. Ça ne se faisait pas trop à l’époque, puisque la plupart des Banyuls étaient surtout des oxydatifs. Pouvez-vous nous rappeler ce que sont les « Rimage » ? Ce sont des Banuyls sur les fruits rouges sur la jeunesse. Les élevages sont assez courts, et les mises sont précoces avec seulement...
Catégorie -L’interview de la semaine
David Landron, vigneron installé en 2022 sur les Coteaux d’Ancenis, cultive 6 hectares de vignes bio sur l’ancien domaine familial à Ligné, à l’extrême nord de l’appellation. Passionné par la diversité des cépages, il mise sur des cuvées équilibrées et naturelles, entre Gamay, Pinot gris et Melon de Bourgogne. Avec son domaine « Passe Pont », il incarne son parcours de vie dans Sèvre-et-Maine et les Coteaux d’Ancenis, cherchant à tracer sa route en toute indépendance. David, vous êtes un nouveau visage sur les Coteaux d’Ancenis, quel est votre parcours ? Effectivement, je suis arrivé en 2022 sur les Coteaux d’Ancenis, je suis enfant de vigneron. J’ai fait des études en viticulture œnologie. Après une première installation dans Sèvre-et-Maine en 2017, avec un éleveur, un maraîcher, nous avons eu une mésentente. Nous nous sommes donc séparés fin 2021. Avez-vous voulu tracer votre propre, loin du domaine familial ? Oui, sur la première installation. Je voulais trouver une agriculture plus sociable. Mon nouveau domaine est basé sur l’ancien chai de mon père, à Ligné, au nord d’Ancenis. Pour autant, je suis indépendant du domaine Landron Chartier. Les vignes appartenaient donc à votre famille ? Oui, lorsque je me suis séparé d’avec mes associés, mon père et mon frère m’ont proposé de rependre 6 hectares de vignes. Ce sont des vignes qui sont en bio depuis 2013. Mon père les avait reprises à son arrivée en 2001. Crédit photo : M57.Studio Pour découvrir la suite de cette interview...
Vigneron installé sur les schistes des Coteaux d’Ancenis, du côté d’Oudon, Jacques Février cultive bien plus que la vigne : il cultive la liberté. Formé en sommellerie, puis passé par l’Alsace avant de revenir dans l’Ouest, il trace son propre sillon en dehors des cadres, assemblant des cépages, jouant des millésimes et explorant sans relâche. Entre expérimentations, météo capricieuse et engagement en bio, il raconte son parcours d’artisan du vivant, où chaque cuvée est d’abord une idée, et, souvent, un jeu. Jacques, comment vous êtes-vous retrouvé vigneron sur les terroirs des Coteaux d’Ancenis ? Avant toute chose, j’ai une formation en sommellerie. Dans le prolongement, j’ai aussi été attiré par le travail de la vigne, donc je me suis lancé dans une formation spécifique en Alsace, en 2011. Je suis originaire de Bretagne, donc, je souhaitais revenir dans l’ouest de la France. Après une première recherche dans le Muscadet et aussi en Anjou, les Coteaux d’Ancenis se sont présentés. J’y ai trouvé un potentiel pour avoir de jolis rouges à base de Gamay. En blanc, il y avait aussi le Pinot gris qui me rappelait un peu l’Alsace, puis le Melon de Bourgogne pour le Muscadet. Un domaine à taille humaine s’est présenté avec un lieu pour vinifier, ce qui n’est pas forcément facile à trouver, dans toute région viticole. C’est donc une reprise ? Le vigneron avant moi faisait du vin pour le négoce. Il récoltait ses raisins sur ses parcelles, puis les vinifiait et les vendait au...
Surplombant la Loire depuis l’un des plus beaux points de vue des Coteaux d’Ancenis, le Domaine des Génaudières cultive bien plus que de la vigne : une histoire familiale séculaire, un attachement profond à la terre, et une volonté affirmée de transmission. Entre patrimoine et innovation, passage au bio, et renaissance du Malvoisie, rencontre avec une famille de vignerons, à l’aube d’une nouvelle génération. Pierre-Yves, votre domaine est situé sur l’un des lieux les plus magiques des Coteaux d’Ancenis, mesurez-vous cette chance ? Oui, nous en sommes conscients ! Tous les matins, quand nous arrivons au travail, nous redécouvrons la vue. Elle change tous les jours selon la luminosité, selon le niveau d’eau de la Loire. C’est un écrin de verdure avec énormément d’arbres, d’oiseaux. Nous avons un cadre de travail très agréable. Est-ce qu’il y a des spécificités géologiques sur votre domaine ? Nous sommes à l’extrémité du Massif armoricain, notre zone s’appelle le verrou de la Loire. C’est l’endroit où la Loire est la plus resserrée entre ces deux rives, nous sommes sur une zone où les deux coteaux sont très proches. Cette géographie fait que nous avons une accélération de l’air qui arrive de l’ouest, qui donne une zone très ventilée, positive pour la vigne. Le Domaine des Génaudières est un domaine familial ? Effectivement, c’est un domaine familial. Anne et Brigitte, qui sont sœurs, l’ont repris il y a maintenant une quarantaine d’années. C’était déjà le domaine de leur père...
Installé depuis 2008 à La Varenne, au sud de la Loire, sur les coteaux d’Ancenis, Emmanuel Merceron a sensiblement fait évoluer la structure de son domaine. À la croisée des appellations du Pays nantais et de l’Anjou, il a fait le choix du bio et d’une viticulture plus artisanale. Réduction des surfaces, valorisation des vins, vinifications en évolution constante : son parcours est marqué par une adaptation aux nouveaux défis de son métier.
Emmanuel, pouvez-vous nous situer votre domaine ?
Le domaine est situé à La Varenne, l’une des neuf communes qui composent désormais Orée d’Anjou, sur la rive sud des coteaux d’Ancenis.
Votre domaine est à la croisée des chemins ou des appellations ?
C’est exactement ça ! De mémoire, nous pouvons ici produire jusqu’à neuf AOC ! Nous sommes à cheval sur les appellations du Pays nantais et celles de l’Anjou, et puis nous avons celle sur laquelle nous sommes situés : les coteaux d’Ancenis. Cela nous a longtemps donné un certain avantage et de très nombreuses possibilités : Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou, Crémant de Loire, Muscadet, Muscadet coteaux de la Loire, coteaux d’Ancenis, ainsi qu’en IGP Val de Loire.
Y a-t-il aussi des inconvénients à pouvoir revendiquer toutes ces appellations ?
Je dirais que nous ne sommes pas au cœur des appellations. Nous sommes donc toujours un peu vus de loin par les autres.
Joanes Haritschelhar, enfant du pays d’Irouléguy, a repris les rênes du domaine familial après la retraite de sa mère, avec une vision claire : produire un vin respectueux de la nature. Si sa mère livrait jusque-là ses raisins à la cave coopérative, le jeune vigneron a, quant à lui, décidé de voler de ses propres ailes avec ses 3 hectares de vignes. Joanes, peut-on dire que vous êtes un enfant du cru ? J’ai grandi au sein de la ferme familiale. Mon père faisait du fromage de brebis, et ma mère l’aidait à la ferme. En 1995, un groupement foncier agricole a été créé dans le village d’Irouléguy. Cela a permis l’installation de cinq ou six vignerons, dont ma mère. Elle a donc eu l’opportunité de reprendre deux hectares de terres agricoles grâce à Lurzaindia. Pouvez-vous nous expliquer la nature de cet organisme ? C’est un organisme basque qui s’apparente à « Terres de Liens », présent partout en France. Il achète des terres, ce qui permet à de jeunes agriculteurs de s’installer plus facilement. Ma mère louait donc ces terres. Or, lorsqu’elle est partie en retraite, comme j’étais son fils, j’étais prioritaire pour les reprendre. Ces terres ne m’appartiennent pas, mais, étant fermier, j’ai un bail qui me garantit de pouvoir les utiliser, sans pouvoir les vendre. Cela signifie que ces terres sont sauvées de la spéculation foncière et qu’elles auront toujours une vocation agricole. Ma mère a donc planté deux hectares de vignes, et j’ai toujours baigné dans cet environnement. Votre...
Didier Ybargaray est un nouveau vigneron à Irouléguy. Un vigneron qui a fait le choix de se consacrer aux vins blancs. En plantant Petit et Gros Manseng sur une parcelle familiale, il mise sur la qualité et la simplicité. Pour lui, le blanc représente bien plus qu’une mode : c’est une évolution prometteuse pour l’appellation.
Didier, quel est votre parcours ?
Je n’ai pas suivi d’étude dans le vin. J’ai d’abord travaillé trois ans et demi en Vendée. Je suis parti à 20 ans et j’ai eu le mal du pays. Je suis donc revenu dans le coin. Mon oncle avait une ferme avec des brebis, mais je n’avais pas le goût de l’élevage. Toutefois, j’avais une forme de regret à ne pas avoir fait d’étude en viticulture qui ressortait de plus en plus. Mon goût pour le vin est arrivé avec le temps.
Vous vous êtes lancé sur une parcelle sans vignes ?
En effet, cette parcelle était à l’origine une prairie exploitée par plusieurs générations de ma famille. L’appellation étant fragmentée en îlots, savoir qu’une parcelle s’y trouve signifie généralement que l’exposition et la qualité du sol sont favorables. Le temps nous a donné raison, car la vigne s’y est parfaitement implantée, affichant une belle vigueur au fil des années.
À quand remontent les premières plantations ?
Nous avons planté un hectare en deux étapes, réparties sur deux années. À l’aube de notre aventure, nous avons choisi une approche progressive : une première partie a été plantée en 2021, suivie de la seconde en 2022.
La cave coopérative d’Irouléguy est l’une des plus petites de France. Sur ce vignoble, elle tient une place à part, puisque c’est grâce à elle que l’appellation est née en 1970. Bien qu’elle représente encore la moitié des volumes de l’appellation, sa place diminue au fil des années. Olivier Martin, son président, nous raconte son histoire et les enjeux qu’elle doit affronter dans le futur. Quelle est l’histoire de la cave coopérative d’Irouléguy ? Avant toute chose, il est essentiel de rappeler que le Pays basque est une terre de vignes et de vins. Jadis florissant, on a compté jusqu’à 1 000 hectares de vignes sur les communes d’Irouléguy, de Baïgorry et d’Anhaux. Le vignoble connut de sombres heures, frappé successivement par la crise du phylloxéra et les bouleversements de la Première Guerre mondiale, qui précipitèrent son déclin. Pourtant, quelques visionnaires ont arpenté les fermes en demandant aux propriétaires de ne pas arracher leurs vignes. L’idée était de valoriser cette production historique. Ce petit groupe de paysans et de propriétaires terriens a créé le syndicat des vins d’Irouléguy au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Petit à petit, l’arrachage s’est arrêté, mais il fallait aussi valoriser la production. C’est ainsi que la cave coopérative est née en 1952. Elle a longtemps été le premier et le seul opérateur sur les terroirs d’Irouléguy. Quelles étaient les surfaces à cette époque ? Il devait rester une trentaine d’hectares ! L’appellation...
Depuis 2012, Brice Robelet, accompagné de sa compagne Elorri Reca, est à la tête du Domaine Bordaxuria. Créé par les parents d’Elorri au milieu des années 1980, ce domaine se distingue par ses vignes quasi exclusivement plantées en terrasses. Si elles façonnent les paysages d’Irouléguy, ces terrasses imposent aussi un travail exigeant et de nombreuses contraintes.
Brice, sur l’appellation Irouléguy, vous êtes l’un des domaines avec le plus de terrasses plantées en vignes ?
Effectivement, la quasi-totalité du domaine est constituée de terrasses. Sur l’AOC, le domaine Brana en compte également un grand nombre, autour de 10 à 15 hectares. Chez nous, sur nos 10 hectares, 8 sont plantés en terrasses, ce qui représente 108 niveaux.
Un travail spécifique ?
Pour donner un exemple concret, sur les terrasses, nous plantons environ 2 000 à 2 500 pieds par hectare, alors qu’une vigne en pente directe, comme celle devant notre domaine, peut en accueillir 4 800 pieds par hectare. Côté rendements, nous sommes à environ 25 hl/ha en terrasses, alors que le cahier des charges de l’AOC autorise jusqu’à 55 hl/ha.
Que représente le travail sur les terrasses ?
Nous avons la chance que les parents d’Elorri aient créé des terrasses assez larges, ce qui permet de mécaniser une partie du travail. Moi qui viens de la vallée du Rhône Nord, où les vignes sont plantées à 10 000 pieds/hectare, rien n’y est mécanisable ! Ici, la largeur des terrasses facilite aussi la sécurité lors des interventions.
Installés sur les terroirs de Vouvray depuis 2022, Anne et Jeroen De Sutter, un couple belge passionné de vin, se sont lancés dans l’aventure viticole après un parcours riche d’expériences en France. Entre apprentissage auprès de vignerons renommés et engagement pour une viticulture bio, ils façonnent aujourd’hui des vins portés par la minéralité et la fraîcheur du terroir. Des Belges à Vouvray, c’est insolite !? C’est vrai que nous ne sommes pas nombreux ! (Sourire) Avec ma femme, nous n’étions pas malheureux dans nos métiers respectifs en Belgique, mais ce n’était pas une passion. Personnellement, pendant plusieurs années, j’ai suivi des cours sur le vin, par passion cette fois. Nous sommes venus en France en 2019 et avons fait les vendanges à Chinon, au domaine Grosbois. Au début, nous voulions simplement voir comment cela se passait. Finalement, nous y sommes restés dix mois. Cette expérience nous a confortés dans notre cheminement. Par la suite, nous avons suivi un bac professionnel viti-vini à Amboise avec des stages. Chez quels vignerons vous êtes-vous formés ? Je suis allé du côté de Montlouis-sur-Loire, au domaine des Pierres Écrites. Ce sont de véritables personnes de confiance, qui sont devenues des amis. Quant à Anne, ma femme, elle a travaillé dans la Loire également, chez Frantz Saumon, puis chez Laura David dans la vallée du Rhône. Ensuite, nous sommes allés à Gaillac avant de revenir en Touraine, chez Vincent Carême et Benoît Pinon. Par rapport à votre...